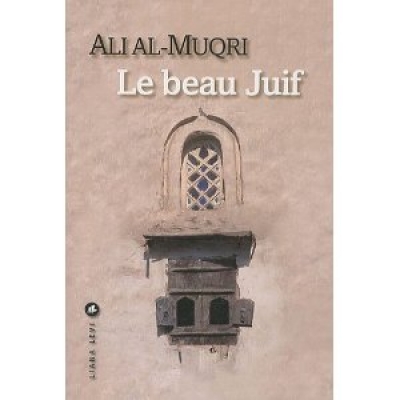Dans tous les romans précités, l’auteur décrit tantôt une simple liaison avec une Occidentale, tantôt un mariage. Souvent, l’épouse se convertit à la foi de son mari, parfois elle conserve sa religion, l’islam permettant à un musulman d’épouser une non-musulmane, pourvu qu’elle appartienne à une « Religion du Livre » – c’est-à-dire principalement au judaïsme ou au christianisme.
Imaginer la situation inverse – une union entre une musulmane et un chrétien par exemple – est plus rare, puisque l’islam interdit théoriquement le mariage d’un non-musulman avec une musulmane. Certains auteurs ont pourtant envisagé la chose dans leurs romans, comme les Libanais Rachid Daif dans Cher Monsieur Kawabata (1995) et Alawiyya Sobh dans Maryam ou le passé recomposé (2002), ou encore le Palestinien Mahmoud Shuqayr dans sa nouvelle La photographie de Shakira (2003) – mais dans tous ces cas ces unions sont simplement évoquées, sans constituer l’intrigue principale de leur œuvre.
L’écrivain yéménite Ali Al-Muqri a imaginé un tel scénario, entre un juif et une musulmane de surcroît, et en a fait la trame de son roman intitulé Le beau juif (Al-yahudi al-hali en arabe yéménite), paru l’an passé en traduction française chez Liana Levi : dans un petit village yéménite, quelque part au 17e s, alors que les relations entre musulmans et juifs sont assez tendues, Fatima, fille du mufti du petit village de Rida, tombe amoureuse de Salim, un artisan juif qui effectue des travaux dans leur maison. Elle lui apprend à lire et à écrire l’arabe, puis lui demande de lui enseigner l’écriture hébraïque. Ils se voient régulièrement, malgré la méfiance des deux communautés, et finissent par se marier.
On s’attend bien sûr à ce que « le beau juif » se convertisse à l’islam pour pouvoir épouser sa belle – un scénario conventionnel qui ne s’opposerait pas à la loi religieuse. Pourtant, il n’en est rien : très cultivée, Fatima aurait trouvé dans les écrits des juristes de la charia un passage assurant qu’un juif peut épouser une musulmane. Les deux jeunes gens se marient donc et continuent chacun de suivre les préceptes de leur religion respective. Le couple quitte néanmoins Rida et s’installe dans la capitale, Sanaa, pour éviter l’hostilité des gens du village.
Hélas, neuf mois plus tard Fatima meurt en couche, et le jeune homme se retrouve seul avec leur bébé. L’homme est rejeté tant par les juifs que par les musulmans, notamment lorsqu’il cherche de l’aide pour élever son fils – les premiers disant que le bébé est musulman, comme sa mère, et les seconds qu’il est juif, comme son père. Il décide alors, pour honorer sa femme de manière posthume et non suivant une quelconque justification moralisatrice, de devenir musulman. Mais cette conversion n’atténue guère l’animosité des gens à son égard, si bien que lorsqu’on lui demande quelle est la doctrine islamique qu’il suit, il est sur le point de répondre : « la doctrine de Fatima. »
Au-delà de la singularité de cette histoire d’amour, assez exceptionnelle dans la littérature arabe contemporaine, l’auteur insiste aussi sur l’intolérance religieuse et la méfiance mutuelle des deux communautés, juive et musulmane. Il rapporte aussi, sans concession, les nombreuses vexations subies par la communauté juive du Yémen, comme l’interdiction faite aux juifs de construire des maisons plus hautes que celles des musulmans, l’interdiction de monter à cheval ou la nécessité de porter des habits distinctifs.
Dans un pays pourtant très conservateur sur le plan religieux, un écrivain de renom n’hésite donc pas à prendre la plume pour traiter des relations interconfessionnelles de façon inattendue et, au-delà, de l’intolérance religieuse, sans ménager sa propre communauté. Il faut dire qu’Ali Al-Muqri est un habitué des textes iconoclastes : son roman précédent (« Saveur noire, parfum noir »), qui n’a pas encore été traduit en français, traitait du sort réservé dans son pays aux Akhdam, parias d’origine africaine vivant dans les bidonvilles ceinturant les grandes villes yéménites.
Rappelons qu’avant lui d’autres auteurs yéménites ont abordé la question religieuse de façon peu conventionnelle, comme par exemple Wajdi Al-Ahdal, auteur de Barques de montagne, paru récemment en traduction française (éd. Bachari, 2011), un livre censuré par l’état yéménite lors de sa parution en 2002, et condamné par de nombreux religieux du pays pour son caractère jugé irrespectueux envers l’islam.
Xavier Luffin (ULB).