Force est de constater tout d’abord que les récents attentats terroristes islamistes, en particulier ceux de janvier 2015, ont créé une inflation d’ « experts » du radicalisme et de la déradicalisation ou de la prévention de la violence radicale. Le monde politique aux abois a en effet dégagé des moyens financiers tout azimuts pour essayer à la fois d’expliquer la dite « radicalisation » et la prévenir. Les programmes mis sur pied sont allés de rapports objectifs, voire scientifiques, sur les faits, à la mise en place d’une information alternative produite par les pouvoirs publics afin de contrer le succès des discours radicaux sur les réseaux sociaux, ou de processus thérapeutiques visant à rendre la santé mentale aux individus supposés contaminés par le radicalisme. Diverses recherches ont pourtant mis en doute l’efficacité de contre-discours publics et des missions parlementaires ont dressé un constat critique de certains dispositifs et programmes de prise en charge de la radicalisation constitués à la hâte par les pouvoirs publics, comme ce fut le cas en France, ainsi que l’a soulevé le rapport des sénatrices Benbassa et Troendlé.
Cet effet d’opportunité produit par une actualité dramatique s’est solidifié grâce aux médias qui ont embrayé et donné à lire, à entendre et à voir de nombreux entretiens, enquêtes, articles de fond et documentaires développant à l’envi le thème de la radicalité politique et religieuse. Il en résulte un effet de saturation où les contours entre les polémiques publiques et les débats scientifiques se diluent. Les chercheurs en sciences humaines fondamentales sont convoqués, par exemple, pour s’exprimer sur des questions de sécurité ou de libertés (d’expression et de circulation) qui débordent largement les frontières de leurs disciplines. Plus délicat encore d’un point de vue déontologique, nombre d’entre eux ont réalisé que leurs enquêtes n’avaient pour fonction que de justifier des décisions prises en amont par les décideurs politiques.
Deuxième constat important : le concept de radicalisation n’a, à ce jour, pas été clairement défini par les sciences humaines et sociales. Le terme renvoie à un champ unifiant, mais non pensé. Les chercheurs sont ainsi conduits à travailler avec un prisme téléologique qui empêche une anamnèse des faits observés et une véritable approche empirique. Ce biais méthodologique est contraire à toute méthode scientifique, voire en inverse la démarche, en lisant les causes à travers les conséquences.
Il faut souligner par ailleurs que le caractère unifiant du terme est signifiant de son extension sémantique. Le fait qu’il renvoie à un nombre incalculable de phénomènes est symptomatique. On parle de radicalisme pour désigner tant les terroristes d’inspiration religieuse que des mouvements politiques plus ou moins violents ou encore des mouvements religieux qui ne le sont absolument pas, ce qui conduit notamment aussi bien à diluer la notion même de violence qu’à ignorer les caractéristiques d’un fait religieux que d’aucuns manient avec peine et un manifeste malaise.
On peut par ailleurs se demander quel est le point commun entre les courants érémitiques religieux et les organisations politiques aux méthodes violentes. Les Témoins de Jéhovah peuvent sans doute être qualifiés de radicaux, mais ils ne sont pas violents. Il est courant d’entendre que le salafisme serait un ferment de radicalisation violente alors qu’il est très largement quiétiste, même si les terroristes qui ont opéré au nom de l’islam ces dernières années puisent aux mêmes références que nombre de courants salafistes. Les attentats suicides ne sont pas non plus l’apanage de ceux qui les justifient religieusement, comme l’a montré a contrario l’exemple du PKK au Kurdistan. Il faut se rappeler que non seulement c’est le propre de certaines idéologies et philosophies d’être radicales, mais qu’en plus toutes se manifestent selon un nuancier qui, à l’extrême, peut se révéler radical.
Les religions connaissent pour la plupart des mouvements de durcissement identitaires et idéologiques qu’on appelle tantôt intégrisme, tantôt fanatisme, tantôt ultra-orthodoxie, tantôt fondamentalisme. Ce lexique a été fort critiqué par les historiens et sociologues des sciences des religions parce qu’il est le plus souvent plaqué d’une manière arbitraire et qu’il correspond à une nébuleuse de mouvements sans lien commun entre eux. Le nouveau venu du lexique, le radicalisme, est sujet aux mêmes critiques. Accolé à des mouvements idéologiques tant religieux que politiques, son emploi est aléatoire et donc peu pertinent. Si nous reprenons l’exemple du salafisme, il est évident que ses contours et son contenu n’ont rien à voir s’il est à l’oeuvre en Arabie saoudite ou en France. Le nicher dans la catégorie « radicalisme » sans opérer pareille distinction est donc à tout le moins inadéquat.
À y regarder de plus près, la question de la violence n’est pas plus simple à manier et surtout à qualifier. Certains militants de causes écologiques peuvent avoir des comportements qui confinent à la violence, mais ne commettent pas d’actes terroristes et/ou criminels pour autant. La notion de violence est à recontextualiser car elle est éminemment relative. Elle peut être perçue comme légitime à certains moments de l’histoire et perdre ce statut à d’autres, et inversement. Dans les régimes démocratiques, la violence est essentiellement une violence d’État, et un apanage de celui-ci. De la sorte, elle peut s’incarner dans des structures ou se manifester dans des événements. Le rapport au temps, quand on l’analyse, est donc fondamental.
L’absence d’appareil théorique pour encadrer le lexique utilisé a pour effet de créer des chaînes causales sans assise, ni empirique ni logique. Dans le discours social, dans la presse et dans le sens commun, il est devenu courant d’associer banlieues françaises, radicalité/radicalisation, terrorisme, Moyen-Orient, désarroi ou trouble psychologique/psychiatrique, jeunesse, impécuniosité, chômage et discrimination socio-économique. Si certaines trajectoires individuelles et collectives correspondent à tous ces critères, elles ne sont pas généralisables, tout comme la dialectique entre dé-socialisation et sur-socialisation complexifie la compréhension de symptômes qui échappent à des logiques simplistes. Il faut en effet de solides bases à la fois théoriques et empiriques pour saisir les liens étroits mais subtils entre idéologie, croyance et imaginaire.
Car s’il y a un rapport entre ces phénomènes, il faut le démontrer ; or, cela n’a pas réellement encore été fait à ce jour. De sorte que l’on peut légitimement questionner certaines expertises supposées qui ont, sans trop la soutenir empiriquement, produit une chaîne de causalité reposant sur le tripode délitement social/mondialisation/déculturation. Davantage de discernement et de prudence seraient pourtant de mise, notamment parce que les quelques études de terrain existantes ont montré qu’il n’y avait pas de profil type des individus dits radicalisés violents, ni de combinaison performante de variables permettant de les identifier — elles ont montré aussi que la psychopathologisation des parcours individuels menait souvent à des impasses.
Tout ceci ne veut pas dire que les sciences humaines ne disposent d’aucun outil pour étudier — à défaut de le prédire — le passage à l’acte criminel au nom de pensées rigides et non négociables. Mais pour ce faire, le contrat scientifique doit être respecté. Selon l’échelle d’observation où le chercheur se place, le degré d’intelligibilité des phénomènes et événements sera évidemment différent et il doit en avoir conscience. D’abord, grâce à une approche psychosociale, il est ainsi possible de mettre au jour les mécanismes multiples d’implication à une dimension micro. Celle-ci fait intervenir des facteurs cognitifs, psychologiques et relationnels, ainsi que des facteurs de socialisation qu’a très bien schématisés Xavier Crettiez.

(Crettiez, Xavier. « Penser la radicalisation. Une sociologie processuelle des variables de l’engagement violent », Revue française de science politique, vol. 66, n° 5, 2016, p. 709-727).
Une approche macro devra en revanche être beaucoup plus sensible aux idéologies et à leurs canaux de diffusion qui nourrissent les affects identifiés au niveau micro, ainsi qu’aux mouvements internationaux et transnationaux qui déterminent les mobilisations collectives et individuelles. La démarche, pour être opératoire, exige de sérier rigoureusement les courants étudiés et les examiner dans toute leur historicité et selon leurs spécificités géographiques. Ainsi, les manifestations d’extrémisme religieux ne peuvent être comprises sans interroger les circulations profondes qui les ont animées. Cela signifie qu’il faut reconnaître aux religions leur autonomie, à savoir la capacité qu’elles affichent à secréter des mouvements spécifiques qui se diffusent par des canaux qui leur sont propres. ll n’y a pas d’équivalence absolue des radicalités religieuses, y compris dans le rapport à la violence. Il faut accepter de rendre compte de la complexité de mouvements parfois profonds et multiples. Il n’existe pas non plus d’unité homogène d’une radicalité générique qui pourrait être accolée à toutes les formes de terrorismes, qu’ils soient politiques ou religieux.
Qu’elle soit micro ou macro, il y a peu de chance que la recherche donne des recettes et des remèdes contre la « radicalisation ». La complexité s’accommode mal d’un tel projet. Mais la complexité est aussi l’apanage de l’intelligence et de la méthode scientifique. C’est pourquoi elle doit avoir une place importante dans l’espace social et les échanges intellectuels. Elle suppose que plutôt que de demander aux chercheurs de produire hâtivement des formules afin de guérir les plaies d’un monde égaré, voire de projeter sur leurs recherches les fantasmes sociaux qui aujourd’hui polarisent nos sociétés et polluent le débat, les pouvoirs publics choisissent plutôt de financer des recherches fondamentales de terrain qui nous permettent de comprendre ce qui est à l’œuvre. Voire permettent aux chercheurs d’interroger non seulement les violences contemporaines, mais aussi d’évaluer les politiques publiques menées pour y faire face…
Cécile Vanderpelen-Diagre et Jean-Philippe Schreiber (ULB).






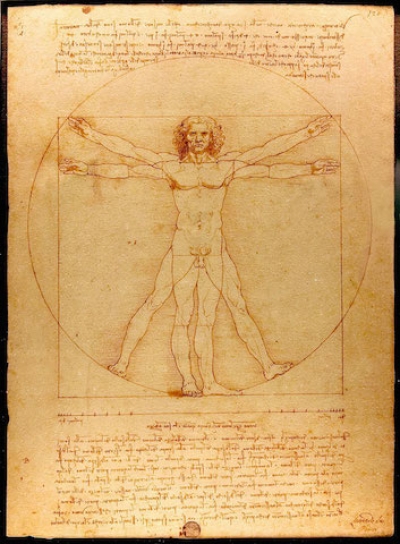
 MangoGem
MangoGem