Car la réforme de la Curie ou du gouvernement de l’Eglise catholique est un thème remontant, pour l’histoire récente, au début du XIXe siècle. Paraissant inefficace, népotique, inadapté et confondant le civil et le religieux, leur fonctionnement ne correspondait pas à l’administration rationalisée et professionnalisée des Etats occidentaux. Dès ce moment, une mise à jour est demandée. Mais les réformes curiale, administrative et politique s’intriquent. Or, la dernière suppose, selon nombre de responsables politiques européens, l’application des principes libéraux : souveraineté nationale, séparation des pouvoirs, droits de l’homme. Soit ce que les papes condamnent depuis la Révolution française, plus encore depuis l’encyclique Mirari vos de Grégoire XVI (1832). L’adaptation paraît donc impossible. Pourtant, Pie IX réalise des réformes libérales après son accession au pouvoir (1846). Mais la révolution romaine, poussant le pape à un exil temporaire, le conduit au rejet de toute libéralisation ou réforme (1848-1850), bien que la centralisation romaine croissante augmente la charge du travail d’administration ecclésiale.
La fin des Etats pontificaux (1870) dissocia pouvoir temporel et pouvoir spirituel du pape. Rendant caduque la réforme des Etats pontificaux, elle modifia le problème : une rationalisation de la Curie devenait possible, en supprimant les inutiles organes du gouvernement temporel. Mais cela nécessitait un renoncement à la souveraineté temporelle, ce qu’aucun pape ne fit jamais. Malgré tout, Léon XIII (1878-1903), fort pragmatique, réalisa des ajustements significatifs. La Curie, désormais surtout gouvernement central de l’Eglise catholique, vit apparaître de nouveaux experts et des conseils inédits au service des congrégations cardinalices. La gestion matérielle du Vatican fut transformée pour garantir une relative autonomie au Saint-Siège. Une dissociation administrative partielle débutait.
Ainsi fut préparée la grande réforme de Pie X (1908). La constitution apostolique Sapienti consilio tira sans le dire un trait sur le pouvoir temporel. La Curie fut clairement distinguée du reste de l’administration pontificale. Ses composantes distribuées en trois catégories (onze congrégations, trois tribunaux, cinq offices), dotée désormais d’un règlement, professionnalisée, appuyée sur le Code de droit canonique (1917), elle assura l’exercice croissant de la souveraineté pontificale jusqu’à Pie XII (1939-1958). Quant au règlement de la « question romaine » par les accords du Latran (1929), s’il suscita une nouvelle administration, celle de l’Etat de la Cité du Vatican, elle fut clairement distincte de la Curie. Mais l’ankylose guettait une administration centralisatrice à la culture juridique et romaine et composée d’un personnel toujours très italien, aux compétences parfois limitées. La réforme de la Curie fut ainsi un thème de Vatican II. Internationalisée, dotée d’un véritable centre de coordination, exprimant une nouvelle ecclésiologie, telle fut la Curie de la constitution apostolique Regimini Ecclesiae Universae de Paul VI (1967). La prééminence de la Secrétairerie d’Etat et du Conseil pour les Affaires publiques de l’Eglise réduisit à neuf les congrégations. Six offices et quatre secrétariats existèrent désormais, sans compter le maintien d’organismes anciens et la création d’organes nouveaux. L’adaptation se poursuivit durant les années 1970.
L’ecclésiologie de Vatican II, qui fit naître un droit canonique accordé à son contenu (1983), conduisit à une nouvelle réforme. Jean-Paul II reformata la Curie avec la constitution apostolique Pastor Bonus (1988) et définit aussi ses normes de fonctionnement (1992). La Secrétairerie d’Etat absorba le Conseil pour les Affaires publiques de l’Eglise. Aux neuf congrégations, trois tribunaux et désormais trois offices s’ajoutèrent douze conseils (auxquels furent rattachées certaines commissions) et d’autres organismes et institutions liées au Saint Siège. Les années passant, des organes surgirent pour traiter certaines réalités spécifiques. La Curie, se spécialisant pour mieux agir, sembla se complexifier sans cesse. Le mode de gouvernement et la vieillesse de Jean-Paul II, tout autant que les logiques bureaucratiques de toute administration, suscitèrent l’attente d’une réforme dès avant 2005. Benoît XVI, contraint par l’inscription du Saint-Siège dans les relations internationales, toucha surtout à la gestion financière. François le relaya, laissant attendre des changements plus conséquences, mais aux contours encore fort incertains.
Ainsi, la réforme de la Curie, choix contraint mais avorté avant 1850, ensuite moyen de l’ecclésiologie intransigeante, puis conséquence de l’aggiornamento de Vatican II, est-elle aujourd’hui une exigence ecclésiale et internationale. Mais elle s’inscrit aussi dans une logique structurelle des administrations étatiques. En effet, le Saint-Siège se trouve dans la situation de nombre d’Etats contemporains : il faut rendre le gouvernement efficace. Tous les Etats ajustent ainsi leurs administrations aux nouveaux domaines d’action et aux nouvelles priorités, faisant surgir de nouveaux organes, bientôt marqués par la bureaucratisation. A cet égard, la Curie est proche d’eux : inflation des autorités, conflits de compétence entre organismes, coordination défaillante, doublons institutionnels, insuffisante professionnalisation...
Pour faire face à ces réalités, les Etats tendent surtout à contrôler les dépenses et à mieux gérer le personnel. Cette réalité vient de faire une apparition inattendue au Saint Siège, avec le Secrétariat pour l’économie. Pour la première fois, les finances vaticanes, associées à la gestion des ressources humaines, sont un organisme autonome directement rattaché au pape. Désormais, le Saint-Siège intègre, en partie, le poids croissant de l’économie comme structuration de la vie humaine, et l’exploitation des capacités individuelles (associée à l’épanouissement individuel) au service de la maximisation de la productivité. Pour autant, il tient encore à distance ces expressions actuelles de l’amélioration de l’administration que sont l’évaluation par objectifs et la gestion par compétences. Visant à rendre plus efficace, plus juste et moins coûteuse l’action étatique, celle-ci conduit à une redéfinition et à un réaménagement du secteur et des services publics, et fait appel à des experts et des méthodes en partie issus des techniques managériales privées. D’ailleurs, même à la Curie, des entreprises d’audit commencent à évaluer la gestion.
Pourtant, rien ne garantit que le nouvel esprit du capitalisme l’emportera au Saint-Siège. Car surgissent deux particularités du gouvernement central de l’Eglise catholique. Tout d’abord, il est au service d’une idéologie, la théologie catholique dans sa version romaine : la réalisation de la communion des Eglises diocésaines, l’accomplissement de la mission de l’Eglise dans le monde et la sanctification des catholiques. Or, ces objectifs restent difficilement évaluables, programmables et planifiables selon les méthodes des Etats contemporains. Manquent donc à la Curie les principaux outils de la rationalisation administrative contemporaine. De plus, en raison de son idéologie, le Saint Siège ne peut se doter d’un corps administratif spécialisé. Le pouvoir suprême y est celui de pasteurs, des évêques promus cardinaux et du pape. Quoique le pouvoir d’ordre soit pouvoir de gouvernement, l’autorité étant à la fois charismatique et rationnelle-légale, quoiqu’il fasse des détenteurs du pouvoir des ministres au service des autres catholiques, le Saint-Siège en est resté au pouvoir pastoral et ne peut se rallier au gouvernement étatique et à sa ministérialité. Les ministres catholiques ne peuvent être ministres de gouvernement, car ils doivent n’être que des pasteurs, dépossédés d’eux-mêmes pour être livrés à leur troupeau. Sous peine de se nier, l’Eglise catholique ne peut se mettre en les mains de techniciens du gouvernement possédant le pouvoir pastoral.
Dès lors le Saint-Siège restera peuplé d’hommes, dont de nombreux clercs (spécialement aux postes de direction), et de femmes (de plus en plus, et pas seulement des religieuses), mal payés en raison d’un budget ridicule, peu nombreux au regard du nombre de catholiques dont ils ont en partie la charge, peu concernés par une logique de productivité. Et ses employés, au moins pour ceux qui ne sont ni clercs ni religieux, verront sans doute d’un œil peu favorable des réformes qui entraîneraient un accroissement de leur charge de travail sans contrepartie financière. Le Saint Siège pourrait ainsi connaître un mouvement social, comme en 1988...
Ainsi, la réforme de la Curie, leitmotiv latent de l’Eglise catholique contemporaine, le demeurera-t-elle très vraisemblablement. Il y aura, encore et toujours, des inadaptations, des bureaucrates, des institutions inutiles, des tensions internes, des conflits de personnes, des scandales et des fuites. Mais il n’y aura pas d’ENA catholique, et c’est sans doute mieux ainsi. Car peut-on imaginer ce que serait un clerc associant tout ce que peut être un évêque et tout ce que peut être un énarque ?
Paul Airiau (Sciences Po, Paris).






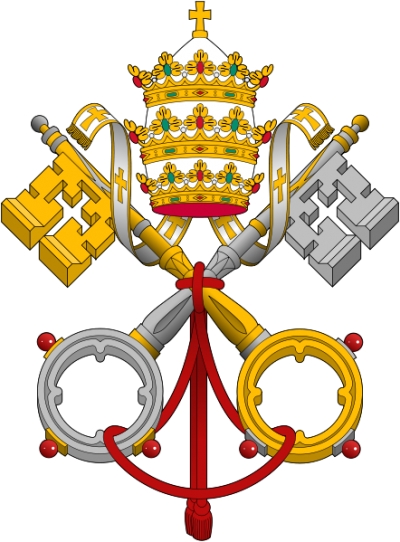
 MangoGem
MangoGem