Résultats de la recherche pour : Cécile
Revue de presse, 8 avril
Laïcité
"Mireille Delmas-Marty, juriste, évoque la « folie normative » et l’obsession sécuritaire qui se sont emparées de nos sociétés dans le contexte conjoint de la pandémie et du terrorisme. Un contexte qui voit l’État s’immiscer de plus en plus ouvertement et délibérément dans des lieux qui ne relèvent pas de son autorité. Ainsi en est-il du devenir de l’Observatoire de la laïcité que la ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur souhaite transformer."— Ennemis d’État ? (Jean-Luc Mouton, Réforme)
"En octobre, dans une note diffusée au sein du gouvernement, consultée par Marianne Matignon jugeait que "l’Observatoire de la laïcité doit évoluer parce que la menace contre la République a radicalement changé."— Marlène Schiappa évoque le remplacement de l'Observatoire de la laïcité (Marianne)
Revue de presse, 7 avril
Société
"If someone tells you they’re going to change your life, you listen, right?" — ‘They mix social media branding with the deep pull of religion’: SoulCycle, OneTaste, and the cult of wellness (Olivia Petter, The Independent)
Belgique
"Le 8 mars dernier s’est tenue une conférence qui a donné la parole à des femmes subissant à la fois de l’antisémitisme et de l’antiféminisme. Il existe un mouvement féministe spécifique au sein de la religion juive, qui tend par exemple à féminiser les textes religieux quand ils parlent de Dieu." — A l'intersection entre le sexisme et l'antisémitisme : "Une grande solitude", selon Viviane Teitelbaum (MR) (Camille Wernaers, RTBF)
Revue de presse, 11 février
Algérie
« Un universitaire et islamologue algérien, Saïd Djabelkheir, va être jugé le 25 février pour offense à l’islam, a-t-on appris mercredi auprès de ce spécialiste du soufisme connu en Algérie » — Algérie : un islamologue poursuivi pour offense à la religion (Le 360)
« Un universitaire et islamologue algérien sera jugé le 25 février prochain pour ‘offense aux préceptes de l'islam’. Il risque entre trois et cinq ans de prison et/ou une amende » — Algérie. Un islamologue poursuivi pour offense à la religion (Ouest France)
Déculturation du religieux : le « rap conscient » comme expression contemporaine de l’islam français
Il y a quelques semaines a débuté le tournage de la deuxième saison de la série télévisée Validé. La première saison de cette série, consacrée au rap et diffusée sur la chaine Canal+, a connu un succès considérable puisqu’elle a été visionnée plus de vingt millions de fois sur la plateforme MyCanal. Apash, le personnage principal de la saison une, était joué par le rappeur Hatik. Ce dernier, qui a vu sa carrière musicale propulsée grâce à son rôle dans la fiction réalisée par Franck Gastambide, a mis en avant son appartenance à l’islam dans ses interviews ainsi que dans ses musiques, particulièrement dans le titre « Cercle vicieux ». L’engagement religieux d’un artiste très populaire pose la question des spécificités et du pouvoir d’influence du rap d’inspiration musulmane et de sa large visibilité.
Les liaisons dangereuses du jeu vidéo et du christianisme
Les amateurs et amatrices de jeux vidéo se réjouiront peut-être de la sortie prochaine de Pope simulator, lancé par le studio polonais Majda Games. Ils et elles auront ainsi l’occasion d’incarner le successeur de Pierre, de «prendre les rênes de la plus grande institution religieuse du monde», dans le but d’utiliser leur «influence pour changer le destin de l’humanité». Alors qu’il n’est pas encore sorti, le jeu suscite déjà des aigreurs, des ricanements et des critiques de la part de certain·es catholiques outré·es que l’on puisse confondre une fonction sacrée et n’importe quel métier profane, ou que l’on puisse «gagner» des points en «pratiquant» sa religion sur écran. Ces réactions sont assez typiques : il n’est pas facile de créer un jeu vidéo religieux. Les développeurs se heurtent tantôt aux normes défendues par les croyant·es, tantôt aux règles d’une entreprise médiatique et culturelle aux exigences esthétiques et technologiques très pointues et dispendieuses.
La vaccination, divine ou maléfique ?
Le monde entier espère que les chercheur·euses trouvent au plus vite le vaccin contre la COVID-19, moyen le plus efficace d’enrayer la crise sanitaire, sociale et économique que nous traversons. Ce vent d’espoir est, pour certains religieux, porté par l’espérance que Dieu pourrait intervenir pour accélérer la découverte. Pour d’autres croyants, le vaccin médical ne soigne de toute façon que les corps, seul compte le vaccin « spirituel ». Pour d’autres encore, cette maladie planétaire est le signe d’une malédiction divine, un châtiment. Vouloir s’en prémunir, c’est s’opposer au dessein divin. Les croyant·es ont donc des opinions très différentes sur le droit et la légitimité de pratiquer la vaccination. Ce n’est pas neuf.
Jean Delumeau, écrivain, historien et chrétien engagé
Le 13 janvier Jean Delumeau est mort, à l’âge de 96 ans. Il laisse derrière lui une œuvre abondante, incontournable pour qui s’intéresse à l’histoire religieuse. Ses ouvrages furent reconnus par les plus hautes instances de consécration des sciences historiques françaises. Ils ont également marqué des générations de chrétiens et de chrétiennes enthousiasmé·e·s par sa vision de l’histoire du christianisme. Sa carrière fut celle à la fois d’un historien et d’un écrivain chrétien, qui a occupé au Collège de France la chaire d’histoire des mentalités religieuses dans l’Occident moderne pendant près de vingt ans, de 1975 à 1994.
Revue de presse, 31 octobre
Sorcellerie
« 31 October 1994 Is the witch the practitioner of black arts, benevolent earth mother, or merely the outsider in her community? » — Myths and magic of the witch – archive, 1994 (Ros Coward, The Guardian)
« Samhain (pronounced sow-ain) is the original Halloween, a modern(ish) version of an ancient Gaelic end-of-harvest festival » — How do Seattle witches celebrate Halloween? A look into the modern religion known as Wicca (Tantri Wija, The Seattle Times)
Corps et religion : Cécile Vanderpelen
À l’occasion de la deuxième édition du festival "La Religion dans la Cité" (Flagey, Bruxelles, février 2019), un certain nombre de femmes expertes ont témoigné, par vidéo, au sujet de la thématique du festival. Nous entendons ici Cécile Vanderpelen, directrice du Centre interdisciplinaire d'Etude des Religions et de la Laïcité et directrice de la Maison des Sciences humaines (Université libre de Bruxelles), parler de corps, christianisme et dualité. Le festival La Religion dans la Cité est une initiative d'ORELA, organisé par l’ULB, la VUB, le quotidien Le Soir et Flagey.
Faire son deuil sur Internet : que font les religions ?
Depuis sa popularisation dans les années 1990, Internet s’est profondément complexifié, offrant des services tant de communication (forums et courrier électronique) que d’information (pages web). Les religions n’ont pas manqué d’investir ce média. En 1983 le premier forum à caractère religieux faisait son apparition et, depuis lors, le phénomène s’est amplifié de manière exponentielle, de telle sorte qu’aujourd’hui, l’un des moteurs de recherche les plus utilisés au monde dénombre des centaines de millions de résultats pour la recherche « religion ». Cette fulgurante expansion témoigne d’un intérêt très marqué, déjà abondamment décrit par les sciences humaines, des religions pour ce média, efficace tant pour créer du lien communautaire que du sens, fût-il virtuel, pour les individus. La question se pose de savoir, d’un point de vue micro, comment il opère lors d’expériences qui touchent à l’intime, tel le deuil.













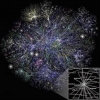
 MangoGem
MangoGem